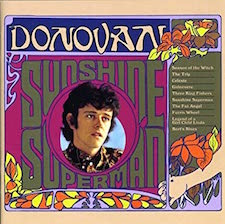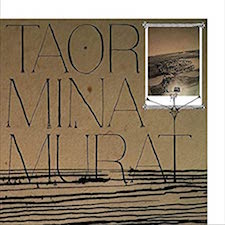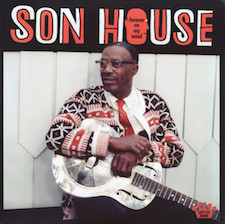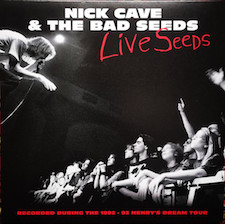Le titre : Fire Doesn’t Grow On Trees
L’artiste : The Brian Jonestown Massacre
Le format : 33T/30 cm.
La date de sortie : 2022
Le genre : Où suis-je ?
C’est qui ?: Un groupe qui a mauvaise réputation
Qui joue dessus ?: Anton Newcombe, Ricky Maimi, Ryan Carlson Van Kriedt, Hakon Adalsteinsson, Uri Rennerts, Sara Neidorf
Comment ca sonne ? : Éperdu
Qualité du pressage :
Bonne.
Edition originale de 2022 – A Recordings LTD – Pressage UK
Ce qu’on en pense :
On avait fini par en avoir marre de The Brian Jonestown Massacre, tout triste qu’on était à l’écoute de leurs derniers albums. On ne sait pas si c’est du à l’exil d’Anton Newcombe en Allemagne, pays des groupes de rock pourris, du National Socialisme et des trains qui arrivent à l’heure, mais il faut bien dire que les albums publiés dans les années 2010 étaient carrément chiants. Le genre de disques qui devraient être livrés avec un sachet d’herbe, sinon c’est mort…
Autre hypothèse, la sortie du film « DIG ! » avait peut être traumatisé Newcombe. Il est vrai que le documentaire montrait un groupe explosant en plein vol, se battant sur scène et finissant par annuler la tournée, défoncés en rase campagne, le van en rade sur le bord de la route. Juste avant l’arrivée des flics. Dans le même temps, le document montrait The Dandy Warhols (quel nom à la con !) signer sur une major et finir sur MTV (alors qu’ils étaient moches comme des poux et que leur musique était sans commune mesure avec celle du groupe de Newcombe).
Pourtant, au milieu de l’épidémie de trucs plus fadasses les uns que les autres, on avait pas lâché l’affaire, se disant qu’un jour ça reviendrait, se contentant d’aller au concerts, le groupe étant toujours resté excellent sur scène.
Pour ce disque, Newcombe a de nouveau composé de véritables morceaux, délaissant les instrumentaux pénibles de dix plombes. 38 minutes, 10 chansons, le tout enrobé dans le son qui les caractérise, principalement basé sur des parties de guitare sonnant comme celles des grands groupes historiques du « psychédélisme ». Un truc qui, en fait, ne veut rien dire, à moins que vous considériez la Reverb, le Flanger ou le Delay comme des drogues dures. Pour être sur de savoir de quoi on parle, il y a même un hommage à « The 13th Floor Elevators » sur le troisième morceau (« It’s about being free really ») comprenant une citation subliminale de la cruche électrique de « You’re gonna miss me».
Digression à l’usage des jeunes :
Pour les rares personnes qui ne connaitrait pas ce titre, allez écouter l’album du groupe de Rocky Erickson « The Psychedelic Sounds Of The 13th Floor Elevators » (premier morceau de la Face A) ou bien la compilation « Nuggets » de Lenny Kaye (dernier morceau de la Face B). On vous envie, c’est un des plus grands morceaux de tous les temps. Et tant que vous y êtes, écoutez la compilation Nuggets en entier.
Une chose est sure, Newcombe est de nouveau à la poursuite de son rêve, pur et sacré, celui de faire de son groupe les Byrds du XXIème siècle, perdu dans le son.